 Denoël, 1938 |
 É. F. R., 1948 |
 É. F. R., 1968 (in Escalade) |
 10/18, 1975 |
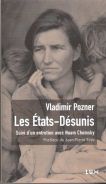
Lux, 2009 (suivi d’un entretien avec Noam Chomsky, postface de Jean-Pierre Faye, préface de Daniel Pozner) / EN LIBRAIRIE
En ces temps de crise, il faut lire et relire cette chronique de l’Amérique de la Grande Dépression. Ce livre clé, « d’une critique impitoyable et d’une grande tendresse » (Jorge Semprun), a marqué les esprits dès sa sortie en 1938. Dans un genre littéraire qui lui est propre, qui tient autant du reportage que de la forme romanesque, Pozner observe et décrit un pays, les États-Unis, alors en pleine détresse spirituelle et matérielle, mais qui ne cesse de fasciner. Ce peuple, l’auteur en sonde l’âme par un puissant montage de détails : la vie quotidienne de Harlem, les briseurs de grève de l’agence Pinkerton, la guerre des journaux à Chicago, les héros déchus de Hollywood, les grèves violentes dans les mines de Pennsylvanie, John Dos Passos et Waldo Frank, le courrier du cœur et les écrivains publics, le marchand de lacets de Wall Street, les gangsters et les croque-morts… Il compose une mosaïque qui renvoie l’image d’un pays où l’énergie le dispute au désespoir, la solidarité à la misère, et où le culte du service et de l’efficacité mène le plus souvent à l’asservissement et au décervelage.
4e page de couverture, Lux éditeur, 2009
Goût d’une prose sèche, précise, nerveuse, parfois violente parfois tendre, désintérêt pour la sentimentalité (mais pas pour les sentiments). Cendrars, Caldwell, Brecht, Hammett admiraient ses romans : nulle surprise, si l’on y songe. Pas de superflu, dans sa peinture de l’Amérique : détestation de Pozner pour toute forme de « perte de temps » ! Mais par le montage, « donner de l’acuité au détail le plus insignifiant en le plaçant à l’endroit juste. » Le portrait cubiste d’un pays.
Daniel Pozner, préface, Lux éditeur, 2009
On connaît en France une Amérique d’images d’Épinal : gratte-ciel, gangsters, vedettes de cinéma, etc., ainsi que l’Amérique, patrie du progrès et du confort. Ces deux pays ont été explorés à fond par de nombreux écrivains et journalistes. L’Amérique faite de chair et d’os – et de sang – est moins connue. Ce livre peut donc aussi bien être considéré comme un supplément fragmentaire à mille et une relations de voyages antérieures.
Toutefois, l’auteur admet volontiers qu’il a trop aimé l’Amérique et les Américains pour avoir songé à être poli à leur égard.
Vladimir Pozner, 1er janvier 1938
En exergue
Le temps de la philosophasserie est passé.
Celui de la photographie est venu.
Jules Vallès, Le tableau de Paris
La cause de l’Amérique est à beaucoup d’égards
la cause du genre humain. Plusieurs circonstances
prouvent déjà (et il s’en élèvera beaucoup
d’autres à l’appui) que tous ceux qui chérissent l’humanité,
doivent prendre part à notre querelle et à nos succès.
Thomas Paine, Le sens commun, 1776
Les premiers mots
… oui, mais le soleil va plus vite. Jailli de l’Atlantique, il prend le départ, à 5 h 26, à Portland, dans le Maine, aux confins du Canada ; à 5 h 30, il est à Boston, douze minutes plus tard, à New York.
A 5 h 47, on le signale à Philadelphie, cité des quakers, à 5 h 48, à Wilmington, capitale des Dupont de Nemours, à 5 h 54, à Washington, siège du gouvernement. A 6 h 06, c’est au tour de l’acier de Pittsburgh, à 6 h 10, aux palmiers de Miami, à 6 h 18, aux automobiles de Detroit. Sans une seconde de retard sur l’horaire, le soleil touche Atlanta, en Géorgie, à 6 h 24, Cincinnati, en Ohio, à
6 h 25, Louisville, dans le Kentucky, à 6 h 29. Les hauts fourneaux de Gary l’aperçoivent à 6 h 35, et les abattoirs de Chicago, une minute plus tard. De soixante secondes en soixante secondes, les villes se succèdent : 6 h 46, Memphis, 6 h 47, Saint Louis, 6 h 48, La Nouvelle-Orléans. Les usines de l’Est tournent déjà et les plantations du Sud bourdonnent ; à présent surgissent les fermes et les troupeaux du Middle-West : Des Moines à 7 h juste, à 7 h 04, Kansas City, à 7 h 10 Omaha. Après les pistes des explorateurs français, des négociants néerlandais, des gouverneurs britanniques, les sentes des pionniers et trappeurs américains. Les cactus du désert, maintenant, et les Indiens
(7 h 17 : Oklahoma City), les Mexicains (7 h 50 : Santa Fe), les Mormons (8 h 13 : Salt Lake City). Un océan sourd à l’horizon ; Los Angeles au sud, Seattle au nord ; et, à 8 h 57, le soleil entre en gare de San Francisco.
Le 21 septembre 1936 commence aux États-Unis de l’Amérique du Nord.
A propos de…
Une lecture indispensable aujourd’hui !
Danièle Sallenave, France Culture, octobre 2009
Cet ovni littéraire, publié en 1938 chez Denoël, apparaît aujourd’hui étrangement moderne et sans frontières.
Martine Laval, Télérama, 2009
Mêlant « choses vues », extraits de journaux et comptes rendus d’entretiens réalisés par l’auteur lors de son séjour outre-Atlantique en 1936, Les Etats-Désunis est un formidable (et très littéraire) portrait de l’Amérique au temps de la Grande Dépression. C’est une sorte de grand reportage, qui fait traverser le pays au lecteur, avec de longues plongées dans les quartiers les plus sordides de New York, des bas-fonds d’Harlem peuplés de petites frappes, de prostituées et de prédicateurs illuminés, à la misérable Bowery Street, au sud de Manhattan, où le froid, en hiver, tuait les pauvres à la chaîne. Vladimir Pozner fait surtout preuve, dans ces pages captivantes, d’une lucidité redoutable.
Thomas Wieder, Le Monde, décembre 2009
Rarement le destin de ces damnés du capitalisme a été restitué avec une si poignante sobriété. Rarement on aura montré avec une telle pertinence ce qui rapproche l’homme d’affaires du gangster. C’est un chef d’œuvre.
Baptiste Touverey, Le Nouvel Observateur, 2009
Les États-Désunis est un livre dont la lecture a été pour moi très importante. C’’est un livre fondamental dans cette tentative de parler de l’inventaire du monde et de l’invention du roman. C’est un livre où l’on peut très bien voir où passe la frontière, parfois difficile à déceler, entre reportage et littérature. Pozner raconte son voyage, et il le raconte d’une façon typiquement romanesque : les premières pages, c’est la description de l’avancée du soleil sur l’Amérique – à telle heure, le soleil est sur New York, etc. Là, on découvre peu à peu le paysage de son livre ; avant même de faire le voyage, le soleil fait le voyage pour vous. Tout à coup, au milieu de la description d’une bataille syndicale, dans une typographie un peu différente, et avec des marges différentes, avec ce jeu du montage des textes, il y a l’histoire d’un Scotty, Walter Scott, de la Vallée de la Mort, qui était mineur. Cette histoire-là prend quelques lignes, et tout à coup c’est un personnage de roman qui apparaît.
Jorge Semprun
Les États-Désunis, Inventaire du monde, invention du roman
Journées Vladimir Pozner, Maison des écrivains, Paris 2005
Avec Pozner, nous sommes aux États-Unis en 1936, surtout à New York, nous lisons le journal du matin, du soir, informations locales et nationales, publicité, prêches se mêlent. Un examen subtil de la phrase informative – que l’information provienne de l’observation ou de la presse – montre un grand travail d’écriture, mais celui-ci tend au resserrement, non pas à l’amplification. La discontinuité de la pensée et du monde est acceptée, soulignée, non pas colmatée par des prouesses rhétoriques. Je définis ainsi l’écriture moderne. Pozner, paradoxalement, a une écriture américaine, celle de Dos Passos, voire de Pound. Citons aussi le Brecht de Dans la jungle des villes et Sainte-Jeanne des abattoirs, le Cendrars de Bourlinguer et de L’or, Maïakovski. Ces artistes de la modernité me semblent vraiment très proches de Pozner ou Pozner proche d’eux.
Hubert Lucot
Journées Vladimir Pozner, Maison des écrivains, Paris 2005
Un art saisissant de créer la synthèse à partir de l’anecdote. Vladimir Pozner nous raconte des histoires, des centaines d’histoires – parfois un long récit, parfois seulement une phrase – et le tableau se précise peu à peu, une logique naît de cet apparent désordre – voici les États-Unis d’Amérique, en version originale à peine sous-titrée ! Une Amérique pleine de bruit et de fureur, où tout se mêle, brutalité et tendresse, inquiétude et orgueil, espoir et aveuglement… Vladimir Pozner a écrit là des pages fulgurantes.
Martine Monod, L’Humanité-Dimanche, 1968
Un reportage aux étonnantes qualités littéraires. La plupart du temps on se croirait plutôt plongé dans un grand et violent roman de la vie moderne américaine, écrit par un auteur impitoyable et clairvoyant. Le reportage haussé jusqu’à ce ton mérite de figurer au premier rang des genres littéraires.
Emile Danoën, Ce soir, 1948
Le livre de Pozner est un beau livre, et un livre important. Il est le premier, sur le sujet essentiel de l’Amérique, à avoir élevé le reportage aux dimensions d’un genre neuf, le documentaire… Le procès de l’Amérique, le vrai procès d’une certaine Amérique, ne peut être fait de façon valable que par des hommes qui aiment les Etats-Unis. Pozner est de ceux-là. Nous avons besoin, comme du temps de Stendhal, de « petits faits vrais ». C’est avec les petits faits vrais qu’on écrit l’Histoire juste.
Claude Roy, Action, 1948
Vladimir Pozner vient d’écrire un livre extraordinaire dans le plein sens du mot. Extraordinaire par le ton autant que par le contenu. Les faits parlent d’eux-mêmes et cette sobriété permet d’atteindre une puissance dramatique prodigieuse. Rien ne peut donner une idée plus précise et plus tragique à la fois de l’inhumaine lutte pour le dollar que l’implacable chapitre intitulé « Cadavres, sous-produits des dividendes ». On chercherait vainement un roman plus passionnant que ce procès-verbal de constat de l’Amérique.
Philippe Lamour, Messidor, 1938
